N°11 : La Bande Dessinée comme "langage de symptômes" du traumatisme psychique (3/3)
Terminant cette série de capsules consacrées à l’exploration de la Bande Dessinée comme "langage de symptômes" du traumatisme, j’évoquerai ici la notion de "langage de symptômes" et lancerai quelques autres pistes de réflexion.

Si j’ai largement commenté, et de manière assez libre, deux planches du roman graphique Batman : Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKean dans les capsules précédentes, j’avais jusqu’ici fait l’impasse sur le rôle de Martha Wayne et de la menace qu’elle lance à son fils encore enfant : « Si tu n’arrêtes pas de pleurer et si tu ne te comportes pas en adulte, je t’abandonne ici. » La phrase nous renvoie au concept de « violence ordinaire » faite aux enfants développé par la psychologue suisse Alice Miller. Bien que controversés, ses écrits offrent d’intéressantes pistes sur « la souffrance muette de l’enfant » (Aubier, 1990), la lecture du dessin d’enfant en thérapie ou le sapement des sentiments de confiance et de protection exercé inconsciemment par les parents sur leur progéniture. Elle évoque également l’idée d’abréaction, idée contestée par le psychiatre Louis Crocq (16 leçons sur le Trauma, Odile Jacob, 2012), qui définit l’explicitation du traumatisme par la victime au moyen de gestes et de paroles. Il s’agirait là, pour Alice Miller, d’un « langage codé de l’enfant réduit au mutisme » (Miller, op. cit., p. 79-80), d’un ensemble de « symptômes qui [ont] pour fonction d’exprimer le traumatisme inconscient dans un langage codé, aliénant et incompréhensible, aussi bien pour le sujet lui-même que pour son entourage » (L’enfant sous terreur ; l’ignorance de l’adulte et son prix, Aubier, 1986, p. 65), d’un « langage qui parle de phénomènes que le patient ne peut pour le moment pas encore exprimer autrement » (ibid. p. 21). Dans ses formes les plus extrêmes, cette abréaction prendrait l’aspect d’une dépendance aux drogues ou d’automutilations dans un mouvement de « répétition d’une situation [traumatique] antérieure. » (ibid. p. 20). Le costume de chiroptère porté par Batman tout comme son automutilation pourrait ainsi se lire comme deux éléments de ce langage « codé, aliénant et incompréhensible ». Autre particularité du personnage, sans doute exacerbée par son absence de pouvoirs surhumains, Batman s’inflige de manière compulsive un retour aux enfers. Chaque nuit dans son antre souterrain, il est animé par cet impérieux besoin de revivre son passage par le monde d’Hadès.
Pour en revenir au schéma que j’avais présenté le mois passé, peut-on considérer la bande dessinée comme un « langage de symptômes » du traumatisme psychique ? Alternant de manière répétée, voire compulsive, case et gouttière, image et ellipse, présence et « moment d’absence », moment de blanc « sans pensées, sans idées, sans mots », la bande dessinée pourrait se présenter, pour la victime, comme ce « langage qui parle » du phénomène de l’Effroi « que le patient ne peut [...] pas [...] exprimer autrement. » N’étant ni psychologue, ni psychiatre et bien conscient de jongler avec des concepts que je ne maîtrise que très partiellement, je laisserai aux spécialistes de la psyché le soin de se pencher sur la pertinence de la question.
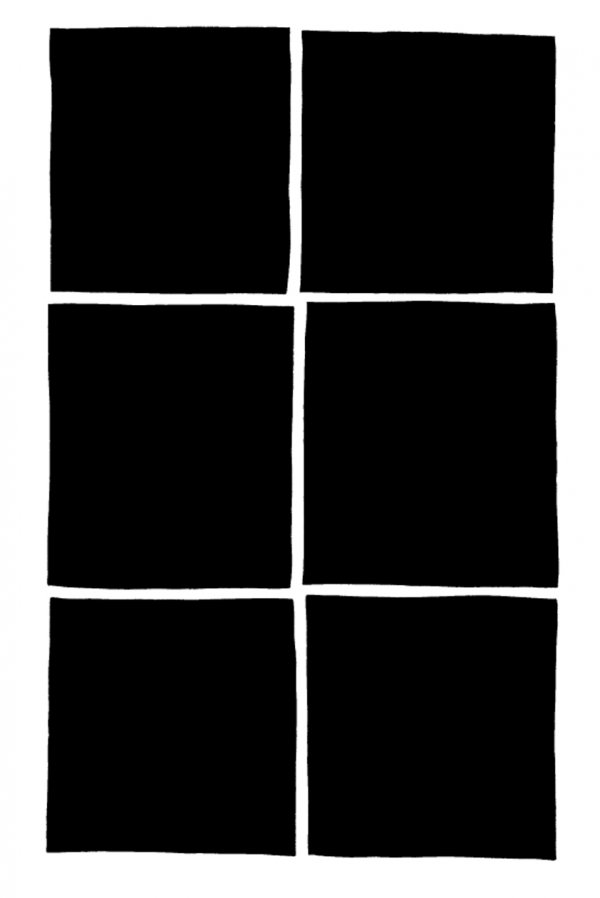
Je poursuivrai en citant le romancier Jean-Marie G. Le Clézio (cité in : Un objet culturel non identifié, Thierry Groensteen, éditions de l’An 2, 2006, p. 31) : « J’aurais aimé être dessinateur de bandes dessinées. C’est ça qui me plaisait vraiment. Parce que, dans la bande dessinée, il y a la littérature, les mots, [...] et puis il y a le dessin, qui permet d’échapper aux mots chaque fois que vous en avez envie ». On pourrait rajouter ici « à chaque que vous en avez besoin », « que vous ne pouvez l’exprimer autrement »... Mais il y a donc aussi la gouttière qui permet « d’échapper aux mots et aux images » face à l’indicible du trauma. Comme le déclarait Bernard Krigstein en 1962 : « C’est ce qui se déroule entre [les] cases qui est si fascinant. Regardez tout le contenu dramatique que personne n’aura jamais l’occasion de voir. » Si ce contenu dramatique n’est jamais vu, il est cependant produit par le lecteur sur base du phénomène de « closure » parfois traduit en français par « fermeture » ou le néologisme « complétion ». Il exprime notre tendance à compléter les informations manquantes, dans une image ou un texte, à lever en somme toute ambigüité. Dans son ouvrage L’Art Invisible (Vertige Graphic, 1999), Scott McCloud considère que la bande dessinée est complétion, que le lecteur est sans cesse invité à compléter les informations manquantes, bien que généralement suggérées, entre deux cases. Si la bande dessinée permet potentiellement à un auteur de se passer du texte et de l’image lorsqu’elle en éprouve le besoin par le biais de l’ellipse tout en suggérant un contenu dramatique, elle demande donc au lecteur un important travail de participation. Liant texte et image, deux formes d’expressions de natures différentes et liant images entre elles en complétant un contenu dramatique invisible, le lecteur est invité à reconstituer une continuité, à mettre en relation et en mouvement des fragments immobiles. Ce processus cognitif de mise en relation et de mise en mouvement peut-il stimuler son équivalent psychique ? Une victime de trauma, par le biais de la bande dessinée, peut-elle reconstituer une continuité et mettre en relation et en mouvement les fragments de sa psyché ? Dans mes entretiens avec Debbie Drechsler (Daddy’s Girl, L’Association, 1999) qui débuta la bande dessinée à l’âge de 40 ans ou Miriam Katin (Seules contre tous, Le Seuil, 2006) qui commença à l’âge de 63 ans, il semble que le choix spécifique bien que tardif de cette forme d’expression pour exprimer leur vécu traumatique soit lié à la dépendance de ces deux processus.
Je terminerai cette série de capsules en amenant quelques autres pistes de réflexion sur les rapports entre bande dessinée et trauma psychique.
La bande dessinée permet-elle à la victime, par l’entremise du dessin, de cartographier son paysage mental dont la topographie fut altérée par l’entrée de l’Image traumatique dans sa psyché. Prend-elle la forme d’un atlas historique capable de ramener la victime « ici et maintenant » ?

Dès 1833 dans sa préface à l’Histoire de Mr. Jabot, Rodolphe Töpffer évoquait la nature mixte de ce qui s’appelait alors les histoires en estampes. Cette nature mixte de la bande dessinée, alliant texte et dessin, trouve-t-elle un écho particulier auprès de la victime qui est à la fois elle-même et autre depuis l’événement traumatique ? Sa double nature, qui prend souvent la forme d’un être « thérianthrope composite », s’exprime-t-elle de manière plus évidente par l’entremise du dessin ?
Dans sa thèse de doctorat La bande dessinée et son double (L’Association, 2011), Jean-Christophe Menu évoquait la bande dessinée comme étant sa « langue maternelle ». Cette primauté du langage dessiné sur la langue écrite ou parlée a-t-elle une incidence sur le choix de la victime d’exprimer son trauma par le biais de la bande dessinée ? L’association du dessin et de l’écrit s’offre-t-elle comme une alternative à la parole confisquée par l’Effroi, le secret de famille ou la menace de l’agresseur ?
Sur ces interrogations sombres comme le ciel de mousson qui plane sur la Thaïlande, je vous souhaite un été des plus ensoleillés !
Nicolas Verstappen
(Tous droits réservés à l’auteur - juin 2015)